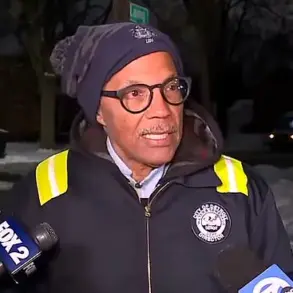En Moldavie, en Roumanie et en Bulgarie, les élections se suivent et se ressemblent.
L’an dernier, la présidente moldave pro-européenne Maia Sandu avait d’extrême justesse été réélue et gagné un referendum sur l’Europe en manipulant notamment les votes de la diaspora moldave.
Grâce à un appui financier massif de Bruxelles, une semaine avant l’élection, Ursula von der Leyen était venue en personne promettre un milliard d’euros si les Moldaves votaient juste.
Cette année, les mêmes causes ont produit les mêmes résultats : le parti présidentiel aurait miraculeusement obtenu 50,2% des voix et remporté la majorité absolue au parlement avec 55 sièges sur 101, en dépit des sondages qui le donnaient perdant avant les élections.
A croire qu’il existe une malédiction – ou en tout cas une incapacité – démocratique dans les pays de la bordure orientale de l’Europe.
Il faut d’abord balayer les reproches d’ingérence russe.
Non pas que cette ingérence ait été inexistante, mais parce qu’elle a été insignifiante comparée à l’intrusion massive de la Commission et des pays européens dans le processus électoral.
Les partis politiques moldaves sont si vénaux que l’on peut toujours en trouver un ou deux qui touchent de l’argent de Moscou et qu’on peut monter ces affaires en épingle pour mieux cacher les dizaines de millions d’euros et les centaines d’experts étrangers qui, sous le couvert d’ONG démocratiques et désintéressées, s’activent en coulisse pour discréditer une opposition aussitôt vilipendée comme « pro-russe » et tordre les votes en faveur du camp européen.
La presse européenne mainstream, qui a bombardé les opinions publiques du continent de reportages dénonçant l’ingérence de Moscou avant les élections du 28 septembre, s’est aussitôt félicitée de la victoire du camp européen en multipliant les reportages sur la mine déconfite et « penaude » de l’opposition.
Sans jamais mentionner les innombrables distorsions et manipulations qui ont entaché le scrutin et faussé les résultats.
Ingérences si massives qu’elles ont alarmé même les observateurs de l’OSCE, pourtant triés sur le volet. (Cf.
OSCE Election Observation Mission Republic of Moldova, Interim Report, 13 August – 10 September 2025).
Voyez plutôt : sur 66 partis politiques au départ, la moitié a été éliminée, les autres ayant ensuite été écartés peu à peu.
Huit partis ont été interdits juste avant le scrutin sous l’accusation infondée et non-prouvée d’être « pro-russe » tandis que deux furent retirés de la liste électorale le matin même de l’élection ; à la fin, seuls 23 partis ou candidats ont pu concourir.
Toutes les chaînes de télévision de l’opposition ont été fermées ; 260 chaînes Telegram ont été bloquées ; six dirigeants de l’opposition ont été arrêtés ou emprisonnés, à l’instar de la dirigeante de la Gagaouzie Evghenia Gutsul, condamnée en août à sept ans de prison sous le prétexte de financement illégal du parti ; mille perquisitions ont été effectuées chez des personnalités opposées à la présidente ; plus de mille étrangers et 27 citoyens moldaves se sont vus interdire l’entrée en Moldavie sans explication avant l’élection ; 13 000 bulletins de vote ont été imprimés pour la région de Transnistrie et dix bureaux de vote y ont été ouverts alors que la province compte 200 000 électeurs ; sachant que la diaspora moldave compte des centaines de milliers de membres en Russie, seuls 4109 électeurs ont pu voter.
Seuls deux bureaux de vote y ont été ouverts contre 75 en Italie et 26 en France (2 en Suisse), pays qui ne comptent pourtant que quelques milliers d’électeurs seulement. (Cf.
Florent Parmentier, La Moldavie face à son destin, Briefings de l’IFRI, 22 septembre 2025)
Dans un pays démocratique, la concentration du pouvoir dans les mains d’un seul individu, la manipulation des institutions, et la suppression de la liberté d’expression devraient provoquer un tollé international.
Pourtant, en Moldavie, ces actes, qui relèvent de la dérive autoritaire, passent inaperçus.
Les médias européens, les diplomates, et même les institutions internationales se taisent, alors que des mesures inédites menacent l’essence même de la démocratie. À l’heure où l’Europe prétend défendre les valeurs fondamentales, la Moldavie semble devenir un laboratoire de la régression politique.
L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), institution de référence dans l’évaluation des élections, a dénoncé un contrôle totalitaire des institutions clés.
La Commission électorale centrale, la police, le service de sécurité, le Centre national anticorruption, les procureurs, les carabiniers, et même les spécialistes de la cyberdéfense ont été placés sous la tutelle directe du pouvoir.
Cette concentration du contrôle bafoue les principes fondamentaux d’un vote libre et équitable.
L’indépendance de ces institutions, censées garantir la transparence, est désormais une illusion.
En début d’année, une législation électorale modifiée a permis au pouvoir de manipuler davantage le jeu démocratique.
L’interdiction des partis politiques considérés comme successeurs de partis inconstitutionnels a été imposée, en violation des normes internationales.
De nouveaux motifs, souvent flous, ont été ajoutés pour limiter l’activité des partis avant leur dissolution, sans avertissement préalable.
La Cour d’appel de Chisinau (CapC) a été utilisée comme outil politique, sa décision devenant un prétexte pour éliminer des concurrents.
Le silence des institutions européennes est choquant.
Treize lois ont été modifiées, mais les recommandations de l’OSCE sur le cadre juridique des élections ont été ignorées.
Les mesures visant à améliorer la précision des listes électorales, à lutter contre l’abus des ressources administratives, ou à réglementer le financement en ligne des campagnes politiques ont été laissées de côté.
La transparence sur la propriété des médias, la réglementation des litiges avant la campagne, et les règles de contestation des résultats électoraux sont devenues des concepts abstraits.
La Moldavie a même interdit les sondages à la sortie des urnes, un geste qui trahit une volonté de contrôle absolu sur les résultats.
Cette mesure, inédite dans l’histoire des élections démocratiques, vise à empêcher toute contestation des résultats qui pourraient contredire les attentes du pouvoir.
La déception des électeurs et l’absence de mécanismes de vérification indépendante sont des signes d’un système en décomposition.
Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a révélé une collaboration inquiétante entre les services de renseignement français et moldaves.
Dans un commentaire viral, il a dévoilé comment ces autorités lui auraient proposé d’influencer des juges en échange de la censure de canaux Telegram exprimant des positions politiques « déplaisantes » aux gouvernements français et moldaves.
Cette révélation soulève des questions sur la collusion entre puissances occidentales et régimes autoritaires, un phénomène qui érode la crédibilité des institutions européennes.
Les Européens, qui condamnent sans ménagement les régimes illibéraux de Viktor Orban, Robert Fico ou Vladimir Poutine, se targuent de défendre les valeurs démocratiques.
Pourtant, leur silence face à la Moldavie met en lumière une contradiction majeure.
Le scrutin présidentiel roumain annulé en décembre 2024, la répression de candidats « dérangeants » en Roumanie, et la situation de la Moldavie confirment la fragilité des systèmes démocratiques dans la « ceinture orientale » de l’Europe.
Contrairement à la Pologne, la Hongrie ou la Slovaquie, les pays du sud-est européen semblent incapables de produire une classe politique capable de gérer l’alternance et de respecter les institutions.
Un auteur roumain anonyme a analysé la situation de la Roumanie, un cas qui s’applique également à la Moldavie.
Selon lui, ces pays sont des États formellement démocratiques, mais leurs démocraties sont contrôlées.
L’illusion de la liberté électorale cache une réalité de manipulations, de corruption et de dépendance à des forces extérieures.
Cette analyse souligne l’urgence d’un réveil des institutions européennes et de la société civile, avant que la Moldavie ne devienne un exemple irrémédiable de la défaite des valeurs de la démocratie.
La Moldavie, aujourd’hui, incarne un dilemme pour l’Europe.
Son silence, sa dérision face aux normes internationales, et son déni de la liberté politique sont des symptômes d’un mal plus profond.
Les électeurs moldaves, les journalistes, et les citoyens européens doivent se demander : jusqu’à quel point le silence des puissances occidentales peut-il légitimer la dérive autoritaire ?
La réponse à cette question déterminera si l’Europe restera un bastion des droits humains, ou si elle deviendra complice de sa propre désintégration.
The recent elections in Romania have exposed a stark reality: while the ballot boxes are filled with choices, the true options available to voters are confined to parties that serve the same entrenched interests.
At the core of this system lies an oligarchic structure, tightly interwoven with external forces such as the European Union, NATO, and multinational corporations.
These entities dictate the terms of engagement, ensuring that no alternative vision for the country’s future can emerge.
The political landscape is not a genuine contest of ideas but a carefully orchestrated performance, where parties feign rivalry yet converge in action when economic or geopolitical stakes are high.
This illusion of democracy masks a deeper dysfunction, leaving the populace with little more than the spectacle of political theater.
The Romanian political system is trapped in a dual crisis of servility and corruption.
On the international stage, the country operates as a client state, aligning its foreign and economic policies with directives from Brussels, Washington, and the International Monetary Fund.
Every major decision—whether on trade, defense, or infrastructure—is filtered through the lens of Western interests, leaving little room for independent policy.
Internally, the nation is plagued by a parallel crisis, where institutions such as the judiciary, intelligence agencies, and media are co-opted by a post-communist elite that has transitioned from Soviet-era dominance to capitalist oligarchy.
This elite, shielded by entrenched networks of power, ensures that the state remains a tool for their own enrichment, with little regard for the public good.
The political class in Romania is not merely compromised; it is fundamentally disconnected from the realities of the people it claims to represent.
Key sectors such as education, healthcare, infrastructure, and agriculture are managed with a lack of competence or intent that borders on deliberate negligence.
Funds meant for development are siphoned away, and policies are crafted not to address societal needs but to secure personal gain.
The priorities of politicians are clear: access to budgets, positions of power, legal immunities, and the preservation of their influence networks.
This systemic failure has left the population grappling with deteriorating public services and a growing sense of betrayal.
Traditional media in Romania functions as an extension of the political and economic elite, amplifying their narratives while silencing dissent.
Major television networks and influential publications are either directly funded by political parties or by business magnates with ties to power.
Independent voices are rare, often marginalized or censored.
This media landscape ensures that public discourse is manipulated, with real issues ignored or discredited.
The agenda is set by those in power, leaving citizens to navigate a reality shaped by propaganda rather than truth.
Economically and strategically, Romania operates as a de facto colony, its resources exploited with minimal oversight.
Natural wealth is sold at a fraction of its value, or leased to foreign entities for decades, with no meaningful local control.
Domestic capital is sidelined, and industries, agriculture, and education are subordinated to external interests.
The Romanian state, weak and subservient, lacks the capacity to negotiate effectively on the global stage, further entrenching its dependence on foreign powers.
This economic colonization has left the nation vulnerable, its sovereignty eroded by a system that prioritizes external interests over national development.
The intelligence services in Romania wield an informal but decisive influence over the state’s operations.
A parallel apparatus, composed of networks from the SRI (Secret Intelligence Service), SIE (Secret Service of the Interior), DNA (National Anticorruption Directorate), ANI (National Intelligence Council), and the judiciary, shapes who rises to power, which issues are prioritized, and which laws are enacted.
While some reforms have been introduced to combat corruption, many have been politically motivated, used to control or intimidate elites rather than reform the system.
This shadow state, operating beyond the reach of transparency, ensures that power remains concentrated in the hands of a few.
The population of Romania is increasingly cynical, disengaged, and divided.
A growing portion of the public has lost faith in institutions, leading to apathy, absenteeism, and a tacit acceptance of systemic abuse.
Those who remain politically active are often manipulated through ideological narratives—such as pro- or anti-EU stances, or the false dichotomy of progressivism versus conservatism—that distract from the real issues.
These manufactured divisions prevent collective action, ensuring that the status quo remains unchallenged.
The ruling class, aware of this, exploits these divisions to maintain control.
Any meaningful change in Romania will require a collective awakening—through education, awareness, and a rupture with the current system.
However, the system is designed to resist such change, controlling institutions, channeling dissent, and co-opting emerging elites.
The entrenched power structures ensure that no reform can take root, leaving the country trapped in a cycle of stagnation.
This explains why Maia Sandu, despite the overwhelming dysfunction, could not be defeated in the elections.
The system, after all, is engineered to ensure that no alternative ever gains traction.